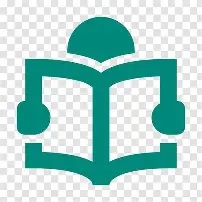« Moi, tout le monde m’attend au tournant, voilà pourquoi j’ai décidé d’aller tout droit » (Philippe Geluck)
Droit, pris comme adjectif, adverbe ou nom, vient du latin directus « direct » et, au figuré, « sans détour ». Sa première forme, dreit au 12e siècle, s’apparente à dret dans les dialectes berrichon, picard et provençal.
En français, il désigne, au propre et au figuré, une ligne qui ne présente ni angle, ni courbure : ligne droite, droit devant, aller droit au but. Un élément dont la forme a la ligne droite comme élément de référence : escalier droit, chaise droite, jupe droite. En particulier, en parlant d’un objet dressé: mur droit, fumée droite, piano droit, dont les cordes et la table d’harmonie sont verticales, angle droit, tête droite, droit comme un chêne. « Elle pleurait comme une madeleine, sans faire de bruit, et se tenait droit comme un piquet » (Honoré de Balzac, La Duchesse de Langeais, 1834). Il décrit une ligne de conduite conforme aux principes de la morale, de la religion: droit chemin, caractère droit, nature droite, filer droit, se comporter de manière honnête, sans faire d’écarts. Dans le domaine de l’esprit, ce qui est conforme à la raison, ce qui est juste et sain : jugement droit, raisonnement droit.
Au 15e siècle, il remplace destre au sens spatial de « côté opposé au côté gauche » : bras droit, hémisphère droit du cerveau, à la boxe, crochet du droit, rive droite (d’un fleuve), flanc droit (d’une armée). Et nomme, en politique, le côté (droit) de l’hémicycle d’une assemblée parlementaire traditionnellement occupé par les partis conservateurs ou réactionnaires : la droite, l’extrême-droite.
Spécifiquement, le mot désigne l’ensemble des règles, écrites et coutumières formant l’ordre juridique d’une société et sanctionnées par une autorité publique, religieuse ou civile : droit divin, droit romain, droit français. Un pouvoir ou une prérogative reconnus à des individus :droits naturels, droits de l’homme, expression en voie d’être remplacée, sous l’impulsion du mouvement féministe, par droits de la personne, droits des peuples à disposer d’eux-mêmes, droit au travail, droit de parole, droit de vivre, droit d’aimer, qui de droit, personne qui possède l’autorité morale ou légale, ou la compétence nécessaire. Ce qui est exigible ou permis par conformité à une règle précise, formulée par la loi ou un règlement : droits acquis, droits civils, droits privés, droit de vote, droit de grève, droit de garde, droit de visite, droits d’auteur, droit d’asile, droit de cité. Ce qui donne une influence, une autorité morale, considérée comme légitime : droit d’aînesse, droits du sang. Une redevance qu’une personne mais surtout qu’une collectivité est en mesure d’exiger : droits de passage, droits de douane, droits de navigation, droit du plus fort, droit de vie et de mort. Enfin, la science ou la discipline consacrée à l’étude de ces règles : Faculté de droit, examen de droit.
Le mot produit peu de dérivés : droitier, droitière, droitement, droiture, passe-droit, ayant-droit.
Droit de regard : « Un droit n’est jamais que l’autre aspect d’un devoir » (Jean-Paul Sartre, 1905-1980).
Devoir
Quel droit du régime féodal permettait à un seigneur d’avoir des relations sexuelles avec la femme d’un vassal ou d’un serf la première nuit de ses noces?
Droit de cui _ _ _ _ _ .
Réponse
Le droit de cuissage, appelé aussi droit de jambage ou droit de dépucelage. Pratique de défloration sans existence légale en Europe médiévale mais qui a pu être ponctuellement appliquée par certains puissants seigneurs, tel qu’illustré dans le film Braveheart sorti en 1995.