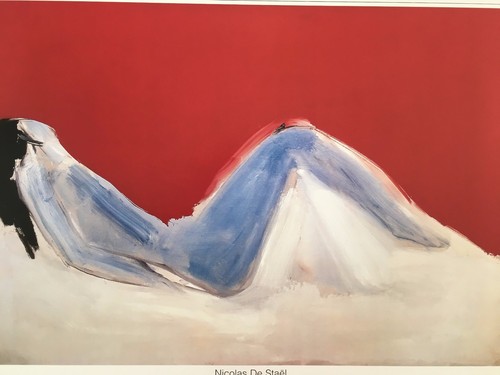« Seule la peau sépare l’amour de l’amitié. C’est mince. » (Éric Emmanuel Schmitt).
Peau, au 12e siècle, est d’abord orthographié pel au singulier, pels, peals, peaus au pluriel. Du latin populaire pellis « peau d’animal », « fourrure », « cuir », « parchemin », qui supplante le latin classique cutis, étymon qui formera cutané.
En français, le mot désigne la membrane résistante, étanche, lavable, élastique qui recouvre le corps des humains et des animaux. Formée du derme en profondeur, richement innervé et vascularisé. Et de l’épiderme en surface, qui joue un rôle de protection des organes et des tissus grâce aussi à ses « annexes » (ongles, bec, cheveux, cornes, griffes, poils), et assure le sens du toucher, même les stimuli les plus légers, la régulation thermique et certaines fonctions d’excrétion. S’agissant de la peau humaine, il forme de nombreux syntagmes : peau blanche, bronzée, cuivrée, douce, fine, lisse, mate, noire, nue, plissée, rêche, ridée, sèche, sensible, veinée, maladie de la peau, soins de la peau, lambeaux de peau.
Il désigne la dépouille de certains animaux portant encore leurs poils, détachée et traitée sous forme de cuirs ou de fourrures : tannage des peaux. Il décrit l’enveloppe extérieure, comestible ou non, qui recouvre certains fruits et légumes : peau de pêche. Et la fine membrane qui se forme à la surface d’un liquide par évaporation ou refroidissement : peau de lait.
Par rapprochement intime du corps, à l’apparence extérieure ou à la personnalité de quelqu’un, il produit plusieurs locutions pour la plupart encore usuelles : à fleur de peau, à la sensibilité exacerbée; être en peau, pour une femme, en grand décolleté; avoir la peau dure, être très résistant, endurant, n’avoir que la peau sur les os, être très maigre; faire la peau, tuer; risquer sa peau, s’exposer; attraper par la peau du cou, du dos, du cul, saisir de manière énergique, sans ménagement; coller à la peau, être inséparable de quelqu’un; avoir (quelqu’un) dans la peau, en être très amoureux; se mettre dans la peau (de quelqu’un), s’identifier à lui; s’user la peau, travailler beaucoup; coûter la peau des fesses, valoir très cher; être bien (ou mal) dans sa peau; être satisfait ou non de ce qu’on est; faire peau neuve, changer de conduite, de comportement; vielle peau, péjorativement personne âgée, peau de vache, salaud.
Rares, les dérivés viennent de la forme ancienne du mot, pel : pelletier, fourreur, pelleterie, peaux animales pourvues de poils transformées en fourrure. Et moderne : peaucier, muscles peauciers, qui s’attachent à la face profonde du derme, peaussier, artisan qui prépare les peaux, peausserie, leur commerce. Peau-rouge, mot obsolète, désigne ce qui est relatif aux Autochtones d’Amérique du Nord.
Devoir
Quelle expression familière décrit, au figuré, un piège, un obstacle susceptible de faire perdre pied à un rival ou un ennemi, à le placer dans une situation difficile, embarrassante?
Peau de b _ _ _ _ _.
Réponse
Peau de banane. L’utilisation idiomatique de l’expression, essentiellement liée à l’enveloppe extérieure de la banane, est une caractéristique du cinéma burlesque américain (1912-1940), popularisé par Charlie Chaplin et Buster Keaton. Mais ce style de comédie remonte à plusieurs siècles, William Shakespeare ayant inclus des scènes amusantes de poursuite et de passages à tabac dans ses pièces comme La Comédie des erreurs (1592-1594).