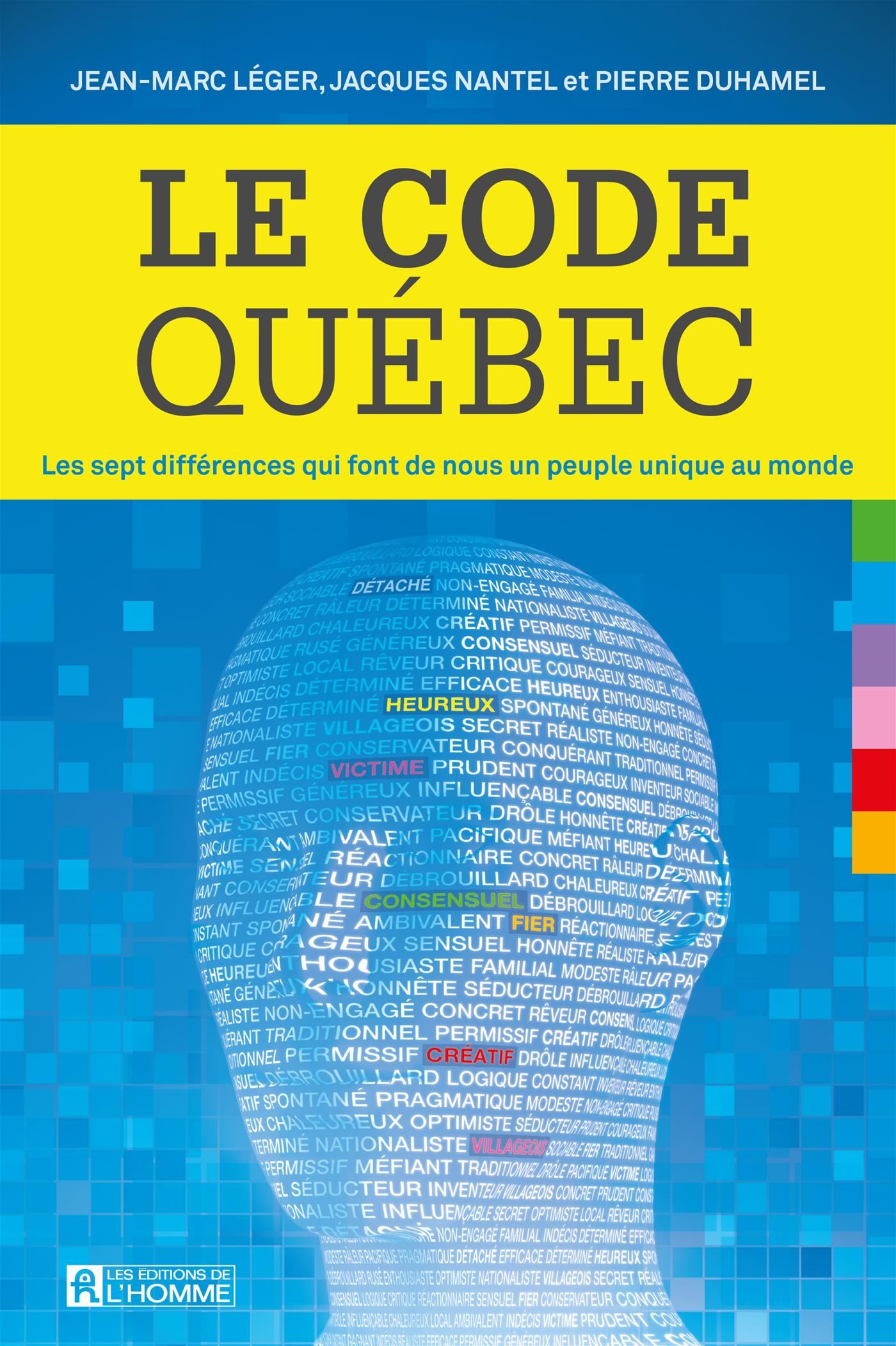J’ai lu Le Code Québec en 2016, année de sa publication aux Éditions de l’Homme. Une enquête menée par Jean-Marc Léger, Jacques Nantel et Pierre Duhamel sous l’égide de la firme de sondages Léger, qui voulait brosser un portrait des Québécois, ce peuple majoritairement issu d’une culture française, vivant dans une société anglaise avec un mode de vie américain. Il y a un mois, j’ai retiré l’ouvrage de ma bibliothèque et l’ai déposé sur mon bureau. Puis j’ai relu les passages que j’avais annotés dans le texte il y a dix ans. Par curiosité. Mais aussi pour savoir si le Québec a changé en une décennie. La moitié d’une décennie si j’avais lu la deuxième édition du livre parue en 2021; la courbe d’évolution identitaire se modifiant si vite à notre époque. En voici des extraits.
(Bien après la Révolution tranquille (années 1960)
« Les attitudes et les valeurs des gens se transforment au fil des années. La différence, c’est que tout s’accélère et que ces valeurs évoluent de plus en plus rapidement. Il y a 30 ans, on estimait qu’une génération s’étendait sur 20 ans. Aujourd’hui, on observe des changements fondamentaux entre les jeunes de 20 et 25 ans. »
(À l’aube du 21e siècle, adieu indépendance)
« Environ le tiers des Québécois se disent plus près de la culture française, le tiers plus près de la culture anglaise et un dernier tiers plus près de la culture américaine. L’Homo quebecensis du 21e siècle se rattache aux trois grandes cultures fondatrices. Le Québec, c’est la fusion originale de ces trois cultures. »
« En somme, les deux tiers des Québécois ne s’identifient pas prioritairement à la culture française. Les Québécois ne sont pas des Français qui ont la singularité de vivre en Amérique du Nord. Ce sont plutôt des Nord-Américains qui parlent français. »
(La langue comme marqueur d’identité)
« Nous avons découvert que c’est la langue québécoise, avec ses mots, ses accents et ses structures de phrase uniques, qui porte en elle toute la charge émotive de notre identité. »
« La parlure québécoise est d’ailleurs un mélange de vieux régionalismes français (bavasser, broue, barnique, guenille, patate), d’amérindianismes (Québec, caribou, ouananiche, ouaouaron), d’anglicismes (stop, checker, hot dog, week-end), d’américanismes (joke, cruiser, bozo, toune) auxquels se sont ajoutés les québécismes (bûche, mouiller, cossin, blonde, char). »
(Les sept traits identitaires des Québécois. Le premier et le plus important : heureux, vivant le moment présent)
« La joie de vivre est au cœur de la différence québécoise. »
« Soixante-quatorze pour cent des Québécois francophones préfèrent vivre le moment présent plutôt que de préparer l’avenir, alors que c’est l’inverse chez les anglophones du Canada. »
« Cette joie de vivre se décline et s’exprime de multiples façons : dans l’amour de la chanson et de la musique, dans la popularité de l’humour et de la comédie, dans l’engouement pour les festivals, les grands rassemblements culturels et sportifs ou dans les plaisirs de la table, de la bonne bouffe au bon vin. » Bonheur qui se traduit également en étant plus permissifs en matière de sexualité.
(Le deuxième trait identitaire des Québécois : consensuels)
« La recherche du consensus fait partie de l’ADN des Québécois et les distingue du reste du Canada. »
« Les Amérindiens valorisaient l’influence du groupe sur l’individu et cet héritage semble se retrouver dans les valeurs des populations métissées qui forment aujourd’hui la Belle Province. »
« Le terme accommodement raisonnable est d’origine québécoise et a été récupéré, par la suite, par les autres pays francophones. Il porte en lui-même l’expression de la recherche permanente du consensus. »
« Les Québécois sont des êtres pragmatiques, prudents et concrets qui font preuve de simplicité et qui ont établi des règles sociales communes autour du gros bon sens. Un sens commun, qui aide à gérer les relations et les conflits entre les gens d’ici, où la recherche du consensus collectif prime souvent la volonté individuelle d’avoir raison. »
(Le troisième trait identitaire des Québécois : détachés)
« L’ancien éditorialiste André Pratte a bien résumé le tout en écrivant que les Québécois sont des Canadiens non pratiquants. »
« En 1914 (début de la Première Guerre mondiale), les Canadiens français ne fournissent que 4 % des volontaires de l’armée canadienne alors qu’ils représentent 30 % de la population canadienne. »
« Cette aptitude à louvoyer et à ne pas aller droit au but cache une certaine indifférence et un détachement qui nous différencient du reste du Canada. »
(Grands parleurs, petits faiseurs)
« Ils se disent les plus croyants mais sont les moins pratiquants. »
« Ils priorisent l’éducation mais sont ceux qui décrochent le plus de l’école. »
« La famille, c’est ce qu’il a de plus important mais c’est ici qu’on se marie le moins. »
« Ils sont les plus heureux mais se suicident en plus grand nombre. »
« Ils ont les plus beaux discours environnementaux mais sont les plus gros pollueurs. »
(Le quatrième trait identitaire des Québécois : victimes. Comportement lié à un manque flagrant d’ambition, à beaucoup de défaitisme et à la peur de l’échec)
« Nelson Mandela, victime de l’apartheid, aurait pu expliquer que c’est la faute des autres, qu’il n’y pouvait rien. (…) Il a plutôt poursuivi son combat malgré 27 ans de captivité. Ne me jugez pas sur mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé à nouveau, a-t-il déclaré. » Paroles sages et une belle leçon pour les Québécois.
(Le cinquième trait identitaire des Québécois : villageois. Esprit de clocher, tutoiement facile, société tricotée serrée)
« Les Québécois sont de véritables villageois qui s’identifient davantage à leur ville ou village et à leur région qu’à leur province ou leur pays. »
« Ils ont une culture d’entraide, de solidarité et de partage dans les petites communautés où tout le monde se connaît. »
« La chose qui importe le plus aux Québécois est la proximité. (…) Quand les Québécois ne sont pas mêlés à une nouvelle, ils ne s’y intéressent pas. »
« Toutes catégories confondues, ce sont René Lévesque, Céline Dion et Maurice Richard qui montent sur le podium du star system québécois. La politique, la chanson et le hockey sont le cœur du Québec. »
« Nos sondages démontrent que la grande majorité des anglophones du Québec s’identifient bien davantage à Montréal qu’à la province de Québec. »
« Les identités de Montréal sont en dissonance avec le reste du Québec. C’est en quelque sorte l’homogénéité des régions face à l’homogénéité de Montréal. »
(Le sixième trait identitaire des Québécois : créatifs. Des idées plein la tête)
« La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse. » (Albert Einstein).
« Le survivance est la première condition gagnante de la créativité québécoise. (…) Les chocs culturels stimulent la créativité. »
Parmi les plus grandes inventions québécoises, sans compter celles des patenteux : la radio AM (1866), le beurre d’arachide (1884), la souffleuse à neige (1925), la motoneige (1937), la livraison à domicile gratuite du poulet (1951), le biberon sans air (1953), le bas-culotte (1954), le soutien-gorge Wonder Bra (1961), la poutine (1964), le casse-tête 3D (1990), le moteur-roue (1994) et les sandales sans odeur Crocs (2001).
(Le septième trait identitaire des Québécois : fiers).
« Les Québécois n’estiment plus que faire de l’argent est un péché. »
« C’est le poids de la nouvelle génération qui influence ces résultats. On trouve même que 40 % des jeunes de moins de 35 ans croient que l’argent fait le bonheur, comparativement à 30 % de l’ensemble de la population. »
« Il y a une aspiration très forte à la réussite chez les Québécois francophones… (qui) se considèrent entièrement comme responsables de leur réussite financière. »
« Chacun des traits identitaires n’existerait pas sans l’autre. Ils sont opposés mais interdépendants. C’est le yin et le yang québécois. »
Est-ce que le Québec a changé en 10 ans? Oui et pour le mieux car il est plus métissé, diversifié et ouvert sur le monde qu’avant. Un mélange de folie latine, de tolérance amérindienne, de flegme britannique, d’obédience catholique, de ténacité nordique, de créativité française et d’optimisme américain. Sept traits identitaires revampés. À la génération des milléniaux de prendre la relève et d’assurer la postérité. À condition d’apprendre à faire des enfants.